Appendice
MODE D’EMPLOI DE LA PLANCHE ANATOMIQUE
– Faites une photocopie agrandie (au format A3) de la première planche sur du bristol et les deux suivantes sur du papier de couleur.
– Prévoyez de la colle (ou mieux : du papier collant) et une paire de ciseaux.
– Vous voudrez peut-être utiliser aussi des crayons de couleur pour mieux distinguer les différents muscles.
Les muscles ont été numérotés dans l’ordre selon lequel il convient de les coller sur le squelette. Cela correspond à la façon dont ils se superposent dans le corps.
Un grand nombre de muscles importants n’ont pas pu être représentés, ceux qui soutiennent les organes notamment, et les ligaments des articulations ont aussi été omis. Avec la pratique, vous apprendrez à identifier tous les muscles qui courent sous la peau de votre partenaire. L’étude de cette planche anatomique devrait aussi vous aider à mieux connaître l’action des muscles et à situer une zone de tension plus profonde que vous souhaiteriez éventuellement traiter.
Sur chaque muscle, la lettre « O » indique l’origine, c’est-à-dire le point d’ancrage sur l’os. C’est cette extrémité que vous devrez coller sur le dessin du squelette.
La lettre « I » représente le point d’insertion fixé à l’os que le muscle est censé mouvoir. Pour mieux suggérer l’action, ne collez pas cette extrémité.
Ne perdez pas de vue, cependant, que les termes « origine » et « insertion » ont été adoptés dans un simple souci de commodité par les anatomistes, qui considèrent le corps en position debout et stationnaire.
Ainsi, le grand dorsal (28) a son « origine » à l’arrière des côtes et du bassin, tandis qu’il « s’insère » dans le haut du bras, qu’il ramène vers la poitrine. (Demandez à un ami de stimuler ce muscle en vous pinçant le bas des côtes, vous sentirez immédiatement des contractions dans les bras.)
Pourtant, dans une autre position, les rôles peuvent s’inverser : si vous vous suspendez à une barre fixe au-dessus de votre tête et si vous tirez pour soulever votre corps (la poitrine est ramenée vers les bras) les notions d’origine et d’insertion sont interverties. C’est l’un des nombreux paradoxes de l’anatomie. Toutefois, par convention, on considère que l’origine d’un muscle est le point le plus proche de la colonne vertébrale ; le point le plus éloigné étant celui de l’insertion.
Nous avons envisagé l’action individuelle des muscles, mais ils sont plusieurs à intervenir, même dans les mouvements les plus simples. C’est leur coordination qui confère à nos gestes cet équilibre de force et de précision qui nous paraît tout naturel dans notre vie d’adulte. Le muscle qui commence une action est appelé « premier moteur », tandis que son « antagoniste » relâche lentement sa tension pour mieux contrôler le geste (l’exemple le plus évident est celui du biceps et du triceps). Les autres muscles voisins qui contribuent à orienter le mouvement sont dits « synergistes ».
Commencez par essayer de superposer quelques muscles sur le dessin du squelette tout en les localisant sur le corps de votre partenaire, puis reconstituez une jambe, un bras ou un côté du tronc et fixez les points d’origine en suivant l’ordre des numéros. Pour chaque muscle, on a dessiné une partie de l’os correspondant à son point d’ancrage sur le squelette.
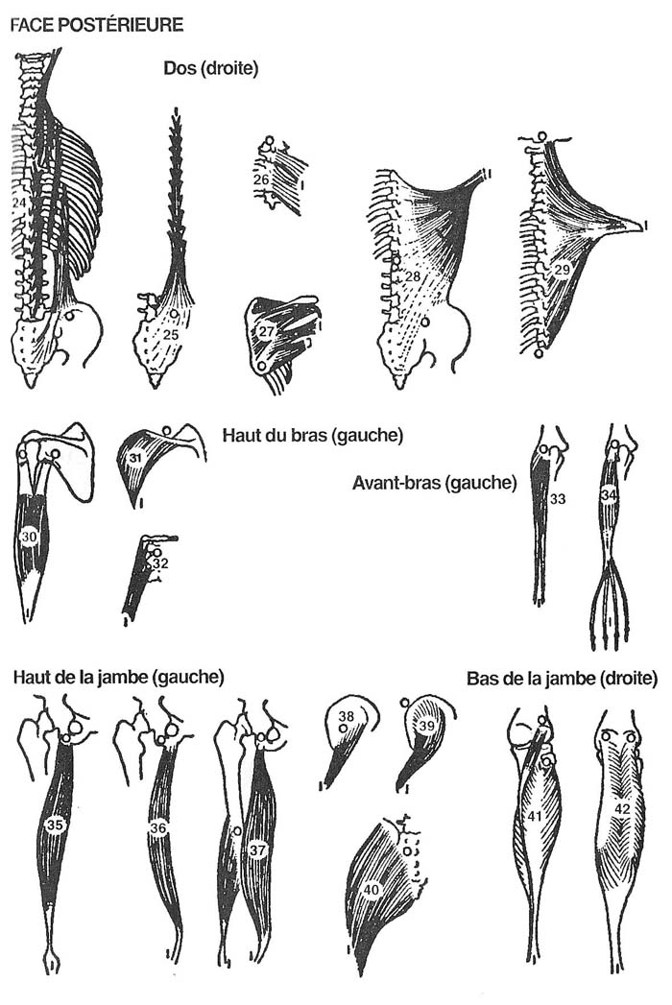
FACE ANTÉRIEURE
Muscle du cou – côté droit
1. Sterno-cléido-mastoïdien : il a son point d’origine sur le sternum et la clavicule, et s’insère sur un point en saillie du crâne, l’apophyse mastoïde. Découpez-le et fixez-le le long de la clavicule et au sommet du sternum.
Action : indépendamment, chacun des deux muscles fléchit le cou et fait tourner la tête ; ensemble, ils fléchissent fortement le cou, tandis que les mouvements de rotation s’annulent réciproquement.
Penchez la tête vers l’avant et tournez-la sur le côté. Vous sentirez le muscle en action. C’est un mouvement similaire que nous accomplissons quand nous relevons la tête de l’oreiller pour regarder l’heure au cadran du réveil, par exemple. Si à ce moment-là nous sursautons en constatant que nous avons dormi trop longtemps, le muscle risque d’être pris de spasmes.
Muscles de la poitrine – côté droit
2. Pectoraux (du latin pectus, « poitrine ») : le petit pectoral a son point d’origine sur les côtes supérieures et s’insère sur l’omoplate. Découpez-le et fixez-le sur les côtes.
Action : contribue au maintien de l’omoplate dans le mouvement de l’épaule.
3. Grand pectoral : il a son origine à la fois sur la clavicule et sur le sternum et s’insère sur l’humérus (haut du bras). Découpez-le et fixez-le le long de la clavicule et du sternum.
Action : tire l’humérus vers l’avant et le fait tourner dans un mouvement rentrant. C’est ce muscle qui modèle le haut de la poitrine et qui forme la partie antérieure de l’aisselle. Quand on fait des « pompes », c’est lui qui accomplit le plus gros du travail.
Muscles du bras – côté gauche
4. Coraco-brachial et brachial antérieur (du latin brachium, « bras ») : le coraco-brachial a son point d’origine sur l’omoplate et s’insère sur l’humérus.
Action : balance le bras vers l’avant, comme pendant la marche.
Le brachial antérieur a son point d’origine sur l’humérus et s’insère sur le cubitus. Action : fléchit le coude.
Découpez-les et fixez-les sur l’omoplate et au milieu de l’humérus.
5. Biceps (étymologiquement, cela veut dire « deux têtes ») : il a son origine sur l’omoplate et s’insère sur le radius (le moins gros des deux os de l’avant-bras). Découpez-le et fixez-le au-dessus du muscle 4.
Action : ensemble, les muscles 4 et 5 fléchissent le coude. Chez les hommes surtout (mais pas exclusivement), le biceps gonfle avec la flexion et forme un renflement sur la partie supérieure du bras.
6. Deltoïde (ainsi nommé à cause de sa forme triangulaire) : il a son origine sur la clavicule et sur l’omoplate et converge ensuite pour venir s’insérer sur l’extérieur de l’humérus. Découpez-le et fixez-le sur l’omoplate.
Action : abducteur de l’humérus, c’est-à-dire qu’il l’écarte de la poitrine. Les épaulettes, sur les uniformes militaires, représentent d’une certaine manière les deltoïdes et sont un symbole de force et de puissance.
Muscles de l’avant-bras – côté gauche
7. Fléchisseur profond des doigts : il a son point d’origine sur le cubitus et s’insère sur les phalanges terminales. Découpez-le et fixez-le sur le coude.
Action : fléchit la dernière articulation des doigts. Pour tester votre contrôle musculaire, voyez si vous êtes capable de fléchir chaque doigt séparément.
8. Fléchisseur radial du carpe : il a son point d’origine sur l’humérus et s’insère sur les deuxième et troisième métacarpiens. Découpez-le et fixez-le sur le coude.
Action : flexion et abduction du poignet. C’est aussi ce muscle qui contrôle les mouvements du poignet quand vous jouez du violon.
Muscles de l’intérieur du bassin
9. Psoas : ces deux muscles ont leur origine sur la dernière vertèbre dorsale et les lombaires ; le petit psoas (muscle iliaque) s’insère sur le bassin et le grand psoas sur le fémur. Découpez-les et fixez-les sur la colonne vertébrale. Action : le petit psoas fléchit le bassin (c’est-à-dire le fait basculer en arrière) ; le grand psoas fléchit la hanche et ramène le fémur vers l’intérieur, comme quand on croise les jambes.
Muscles de haut de la jambe – côté droit
10. Droit interne : il a son origine sur le pubis et s’insère sur le tibia. Découpez-le et fixez-le au bas du bassin.
Action : adducteur du genou (qu’il ramène vers l’intérieur). Il contribue aussi à sa flexion.
11. Grand adducteur : il a son origine sur l’ischion (au bas du bassin) et s’insère sur le fémur. Découpez-le et fixez-le sur le bassin. Action : adducteur (principal) de la cuisse. Les autres adducteurs (non représentés ici) se rappellent parfois désagréablement à notre bon souvenir quand nous faisons de l’équitation (sur la selle ou en croupe) pour la première fois.
12. Vaste interne ;
13. Vaste médial ;
14. Vaste externe : tous trois ont leur origine sur le fémur et s’insèrent avec le droit antérieur sur le tibia, en passant par la rotule. Découpez-les et fixez-les dans le haut de la cuisse. Action : contribuent à l’extension du genou.
15. Droit antérieur : il a son origine en deux points de l’ilion (haut du bassin) et s’insère avec les trois précédents sur le tibia en passant par la rotule.
Action : principal extenseur du genou, mais aussi fléchisseur de la hanche puisqu’il est fixé au bassin.
Les muscles 12 à 15 sont également connus sous le nom collectif de quadriceps (quatre têtes) en raison de leur insertion commune à hauteur de la rotule. Pour sentir le quadriceps en action, donnez un grand coup de pied.
16. Couturier : il a son origine sur l’ilion et s’insère sur le tibia. C’est le plus long muscle du corps humain. Découpez-le et fixez-le sur le bassin.
Action : fléchisseur de la hanche et du genou, il fait aussi tourner la jambe vers l’intérieur. Comme son nom l’indique, c’est ce muscle qu’on utilise pour s’asseoir « en tailleur ».
Muscles du bas de la jambe – côté gauche
17. Long péronier latéral : il a son point d’origine sur le péroné (os grêle externe de la jambe) et s’insère au-dessous du premier métatarsien. Découpez-le et fixez-le sur le genou.
Action : tourne le pied vers l’extérieur et contribue à la flexion (vers le haut) de la cheville.
18. Extenseur commun des orteils : il a son point d’origine sur le péroné et s’insère sur les derniers os des orteils. Découpez-le et fixez-le sur le genou.
Action : étend les orteils et contribue à la flexion de la cheville.
19. Jambier antérieur : il a son origine sur le tibia et s’insère sur la face inférieure du premier métatarsien et de l’os tarsien adjacent (cheville). Découpez-le et fixez-le sur le genou.
Action : tourne le pied vers l’intérieur et contribue à fléchir la cheville.
L’articulation de la cheville comporte de nombreux ligaments très résistants qui la préservent des contraintes exercées par les principaux muscles et par le poids du corps. Mais il arrive que cette protection cède. Il se produit alors une entorse.
Muscles de l’abdomen
20. Transverse : il a son origine sur les vertèbres lombaires, l’ilion et les côtes inférieures ; il est également attaché aux muscles du bas du dos. Il encercle l’abdomen et s’insère à la base du sternum. Un tendon central descend du thorax au pubis. Découpez-le et fixez-le au bassin et aux côtes, mais ne le collez que du côté droit (pour ne pas masquer le psoas, du côté gauche).
Action : maintient les viscères de l’abdomen comme un corset.
21. Grand droit : il a son origine sur le pubis et s’insère sur les cinquième, sixième et septième côtes. Découpez-le et fixez-le du côté droit sur le pubis. (N’oubliez pas que le côté droit du squelette est à votre gauche quand vous le regardez.)
Action : fléchit la colonne en tirant la poitrine vers l’avant et s’associe au transverse pour contenir l’abdomen.
C’est la contraction des muscles à l’intérieur de l’abdomen qui produit l’évacuation par le gros intestin (côlon). En « poussant », on exerce une pression sur l’intestin qui entrave son action et favorise la constipation.
22. Petit oblique : il a son origine sur l’ilion qu’il longe vers le pubis ; il est également attaché aux muscles du bas du dos. Il s’insère sur les quatre dernières côtes et sur le tendon central de l’abdomen. Découpez-le et fixez-le sur le bassin du côté droit.
23. Grand oblique : son origine – sur la cage thoracique – et son insertion – sur l’ilion – sont inversées par rapport au petit oblique. Découpez-le et fixez-le à la section du petit oblique sur les côtes.
Action : ces deux muscles fléchissent le tronc vers l’avant. Si un côté du petit oblique se contracte en même temps que le côté opposé du grand oblique, le tronc pivote, comme quand vous vous asseyez et vous tournez sur le côté en un même mouvement.
Les muscles obliques ont souvent fort à faire pour garder à notre taille une allure flatteuse. Nos efforts héroïques pour renforcer notre musculature abdominale sont quelquefois battus en brèche par nos exercices « masticatoires » : on ne parvient qu’à aplatir la région supérieure, avec pour effet de repousser les organes vers le bas et d’exagérer encore la proéminence du ventre. C’est pourquoi les exercices abdominaux les plus profitables se pratiquent la tête en bas (par exemple dans la posture de yoga en appui renversé sur les épaules), tandis que l’on effectue de lents mouvements de balancement et de flexion des jambes.
Maintenant que la première moitié de la planche anatomique est achevée, vous devez vous être familiarisé avec les notions d’origine et d’insertion. Vous pouvez passer à la seconde partie, sans perdre de vue que le corps humain n’est pas constitué d’un côté face et d’un côté pile, mais qu’en réalité il a plutôt une forme cylindrique, dont l’axe est la colonne vertébrale.
D’après la description de leur action, essayez de reconnaître, parmi les muscles de la face postérieure, quels sont les antagonistes de ceux que vous avez déjà collés sur l’avant du squelette. Par la suite, vous pourrez refaire des photocopies des pages et reconstituer les paires de muscles antagonistes.
Un autre exercice pourrait consister à replacer de mémoire les muscles sur le squelette, en masquant les numéros.
Même avec la pratique, tout le monde n’est pas capable de « jongler » avec l’ensemble des muscles. Si la planche anatomique, dans sa totalité, vous paraît trop compliquée, commencez par un groupe de muscles avec lequel vous vous sentez plus à l’aise et laissez votre curiosité vous porter progressivement vers les autres muscles.
FACE POSTÉRIEURE
Muscles du dos – côté droit
24/25. Sacro-épineux (terme collectif pour désigner les muscles érecteurs de l’épine dorsale) : tous ont leur origine dans le bas de la colonne vertébrale et s’insèrent en remontant sur les côtes, jusqu’au crâne. Découpez l’illustration 24 et collez-la entièrement sur le bassin, l’épine dorsale et la cage thoracique ; fixez la 25 sur le sacrum (au bas de la colonne).
Action : étendent la colonne et le cou en redressant les vertèbres, comme quand on se remet droit sur son siège en quittant une position avachie.
26. Petit et grand rhomboïdes : ils ont leur origine sur la plus basse des vertèbres cervicales (cou) et la plus haute des dorsales, ils s’insèrent sur le bord de l’omoplate. Découpez-les et fixez-les sur les vertèbres.
Action : font pivoter l’omoplate vers la colonne.
27. De haut en bas, les quatre muscles scapulaires :
Sus-épineux : il a son origine sur l’épine de l’omoplate et s’insère sur l’humérus.
Action : s’associe au deltoïde pour lever le bras.
Sous-épineux : il a son origine sous l’épine de l’omoplate et s’insère sur la face extérieure de l’humérus.
Action : provoque un mouvement de rotation du bras vers l’extérieur.
Petit rond : il a son origine sur le bord externe de l’omoplate et s’insère sur la face extérieure de l’humérus.
Action : s’associe au sous-épineux et contribue à maintenir l’emboîtement de l’épaule.
Grand rond : il a son origine dans le bas de l’omoplate et s’insère sur la face intérieure de l’humérus.
Action : provoque un mouvement de rotation du bras vers l’intérieur et contribue à maintenir l’emboîtement de l’épaule.
Découpez l’illustration et fixez-la sur la cage thoracique, le bord juste contre le point d’insertion des rhomboïdes, en collant simplement la petite patte représentant les côtes, de façon qu’il vous suffise de soulever l’omoplate pour voir les muscles épineux.
28. Grand dorsal : il a son origine sur le sacrum, l’ilion et les côtes inférieures ; il s’insère sur la face intérieure de l’humérus. Découpez-le et fixez-le sur la colonne et le bassin.
Action : adducteur du bras, qu’il tire vers l’arrière en lui imposant un mouvement de rotation vers l’intérieur. Il dessine un large « V » sous la peau du dos. C’est ce muscle qui forme, avec les scapulaires, la partie postérieure de l’aisselle.
29. Trapèze : il a son origine sur l’os occipital (à l’arrière du crâne) et le long de la colonne, jusqu’à la dernière vertèbre dorsale ; il s’insère sur les extrémités de la clavicule et de l’omoplate. Découpez-le et fixez-le sur l’épine dorsale et le crâne.
Action : soulève l’épaule et la tire vers l’arrière. Vous pouvez facilement repérer le trapèze en pinçant le bord de l’épaule.
Muscles du haut du bras – côté gauche
30. Triceps (étymologiquement, cela veut dire « trois têtes ») : il a son origine sur l’omoplate et l’humérus, et s’insère sur le cubitus (au coude). Découpez-le et fixez-le sur l’omoplate.
Action : extenseur du coude, en opposition avec le biceps.
31. Deltoïde (vue postérieure) : voyez le n° 6. Découpez-le et fixez-le sur le haut de l’omoplate.
32. Angulaire de l’omoplate : il a son origine sur les quatre vertèbres cervicales supérieures et s’insère sur le haut de l’omoplate. Découpez-le et fixez-le sur le long du cou.
Action : soulève l’omoplate.
Muscles de l’avant-bras – côté gauche
33. Long extenseur radial du carpe (antagoniste du fléchisseur radial du carpe 8) : il a son point d’origine sur l’humérus et s’insère à la base des deuxième et troisième métacarpiens. Découpez-le et fixez-le sur le coude.
Action : extension et abduction du poignet.
34. Extenseur commun des doigts (antagoniste du fléchisseur profond des doigts 7) : il a son point d’origine sur l’humérus et s’insère sur les phalanges terminales.
Action : étend les doigts.
Fermez le poing puis écartez les doigts plusieurs fois de suite pour observer l’antagonisme parfaitement synchrone des fléchisseurs et des extenseurs. Remarquez comment les muscles s’affinent en descendant le long du bras pour n’être plus que de minces tendons passant par le poignet puis dans la main. N’est-ce pas un moyen remarquablement intelligent d’éviter que les mains prennent trop de volume avec l’exercice, comme c’est le cas pour les fibres musculaires ?
Muscles du haut de la jambe – côté gauche
35. Biceps fémoral : il a son origine sur l’ischion et s’insère sur le tibia. Découpez-le et fixez-le sur le bassin.
Action : fléchit le genou et lui impose un mouvement de rotation vers l’extérieur ; extenseur de la hanche.
36. Demi-tendineux : il a son origine sur l’ischion et s’insère sur le tibia. Découpez-le et fixez-le sur le bassin.
Action : fléchit le genou et lui impose un mouvement de rotation vers l’intérieur ; extenseur de la hanche.
37. Demi-membraneux : il a son origine sur l’ischion et s’insère sur le tibia. Découpez-le et fixez-le sur le bassin.
Action : comme le demi-tendineux.
L’illustration 37 représente également la seconde « tête », plus courte, du biceps fémoral, qui a son origine plus bas sur le fémur. En découpant, séparez bien les deux muscles et glissez l’os et le biceps sous les muscles 35 et 36, de façon qu’il soit collé directement sur le fémur, tandis que le demi-membraneux reste par-dessus le groupe de muscles.
Les fins muscles fléchisseurs du genou sont communément appelés le jarret. Au Moyen Âge, un supplice consistait à les couper. Souvent, en cas de blessure occasionnée dans la pratique d’un sport, ces muscles réclament un temps considérable pour guérir, en raison du rôle qu’ils jouent dans la station debout et la marche. Il est facile de localiser au toucher leurs points d’insertion, derrière le genou.
38. Petit fessier : il a son origine sur la face externe de l’os iliaque et s’insère sur le fémur, du côté extérieur. Découpez-le et fixez-le sur le bassin.
Action abducteur du fémur, auquel il impose aussi un mouvement de rotation.
39. Moyen fessier : il a son origine sur la crête iliaque et s’insère sur le fémur. Découpez-le et fixez-le sur le bassin.
Action : comme le petit fessier.
40. Grand fessier : il a son origine sur l’os iliaque, le sacrum et le coccyx. Découpez-le et fixez-le sur le sacrum de façon à pouvoir le soulever pour examiner le petit et le moyen fessier.
Action : extenseur de la hanche ; il impose aussi un mouvement de rotation au fémur, comme dans la figure de danse nommée « arabesque ».
Les fessiers jouent un rôle essentiel dans la station debout et, associés aux jarrets et aux quadriceps, dans la marche. Mais la force de gravité intervient elle aussi, puisqu’elle communique au fémur un mouvement de balancier. C’est pourquoi on a tout intérêt, lorsque l’on se remet de blessures aux muscles postérieurs par exemple, à relâcher en marchant les articulations du genou et de la cheville au moment où la jambe se balance pour effectuer le pas suivant. Cela réduit l’effort à accomplir.
Muscles du bas de la jambe – côté droit
41. Soléaire : il a son origine sur le tibia et le péroné, et s’insère sur le calcanéum (le talon), qui est le plus grand des os du tarse. Découpez-le et fixez-le à l’arrière du genou.
Action : fléchisseur plantaire de la cheville (comme pour se tenir sur la pointe des pieds).
Le fin muscle représenté également, qui a son origine sur le fémur et s’insère sur le calcanéum, est le plantaire, un auxiliaire des jumeaux, ci-après.
42. Jumeaux : ils ont leurs points d’origine sur le fémur et s’insèrent sur le calcanéum.
Action : puissants fléchisseurs plantaires de la cheville ; du fait de leur origine sur le fémur, ils contribuent aussi à la flexion du genou.
Les muscles 41 et 42 donnent de la force à nos pas quand nous marchons vite ou quand nous courons. Quand nous restons immobiles, ils nous permettent de nous dresser sur la pointe des pieds.
Si vous vous intéressez plus particulièrement à une région du corps, vous pouvez faire agrandir encore, à la photocopie, la partie du squelette en question, ainsi que les muscles correspondants. Vous y verrez plus clair.
N’abusez pas de la colle (ou du papier collant), car vous aurez peut-être à corriger la position de certains muscles jusqu’à ce que vous soyez bien sûr de reconnaître la silhouette du corps humain. Mais ne vous découragez pas car, dans l’organisme lui-même, l’arrangement des muscles n’est pas toujours conforme à la description qu’en donnent les livres. Par exemple, on estime que 30 % de la population ne possèdent pas le petit psoas…

